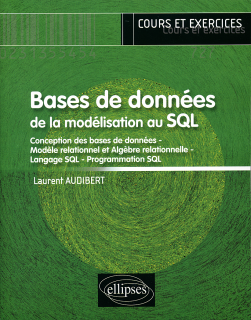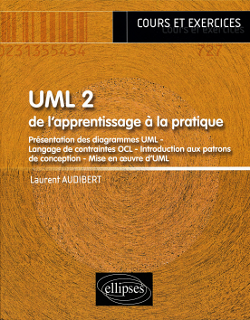Alors que notre monde fait face à des défis environnementaux sans précédent, il est crucial de repenser notre manière de nous déplacer. La voiture électrique se présente comme une solution innovante et écologique, réduisant notre empreinte carbone et contribuant à un avenir plus durable. Dans ce billet, explorons les nombreux avantages de cette révolution silencieuse et propre sur nos routes.
Préambule
Ce discours introductif a été généré par ChatGPT. Je suis sidéré par la course aveugle actuelle de nos sociétés vers la voiture électrique que l’on appelle également la voiture propre. Rappelons que l’Union européenne a entériné l’interdiction de la vente des véhicules à moteur thermique à partir de 2035 (en exemptant cependant la filière automobile de luxe) ! Quand on y regarde de plus près, avec un peu de discernement, de réflexion et de rigueur, on se rend assez vite compte que la voiture électrique est au moins aussi polluante, et malheureusement très probablement bien plus, que celle qu’elle remplace. Dans ce billet, qui promet d’être long, je vais adresser plusieurs aspects de la voiture électrique.
Une voiture électrique, c’est bien mieux qu’une voiture thermique
Une voiture électrique possède de nombreux avantages par rapport à une voiture thermique. Elle est bien plus silencieuse, bien plus fiable, sa puissance est tout de suite et tout le temps disponible. Bref, il est indéniable qu’une voiture électrique est certainement bien plus agréable à conduire et à entretenir qu’une voiture thermique. Mais est-ce vrai dans tous les cas de figure ? Et surtout, est-elle moins polluante que son équivalente thermique ?
Le moteur électrique possède un excellent rendement !
C’est un argument qui revient souvent du côté des défenseurs de la voiture électrique. Le rendement d’un moteur thermique est de l’ordre de 40% (36% pour l’essence et 42% pour le diesel) quand celui d’un moteur électrique atteint les 90%. Il y a une malhonnêteté intellectuelle manifeste à présenter les choses de cette façon.
Du côté de la voiture thermique, cela veut dire que pour 100 unités d’énergie sortant d’une raffinerie (sous forme de carburant), on en récupère 40 au niveau des roues. Notons qu’entre la raffinerie et la chambre de combustion, il n’y a quasiment aucune perte.
Du côté de la voiture électrique, les choses ne sont pas du tout aussi simples. Toutes les étapes de la chaîne énergétique de la centrale productrice au moteur électrique sont entachées de pertes significatives. Reprenons nos 100 unités d’énergie produites par notre centrale électrique. 10% est perdu pour l’acheminement à la borne de recharge de la voiture (il en reste donc 90). 13% (32.5% pour une Renault Zoe R110) sont perdus lors de la recharge de la batterie (il en reste donc 78). Enfin, même avec un moteur avec une efficacité de 90%, c’est en réalité 10% et 25% qui sont perdus entre la sortie de la batterie et la restitution aux roues (pertes côté batterie, onduleurs, transformateur…). La restitution finale aux roues des 100 unités initiales est donc comprise entre 70 et 59. Le rendement énergétique d’un véhicule électrique est donc compris entre 59% (nottament en hiver) et 70% (dans des conditions optimales). Il reste plus favorable que celui du véhicule thermique (40%), mais la différence n’est plus aussi importante. Attention, le rendement de la production de l’énergie n’est pas du tout inclus dans ce calcul. Si la centrale électrique est une centrale thermique (à pétrole) alimentée par une raffinerie, le rendement calculé à partir de la raffinerie devient compris entre 23% et 28%.
Impacts sur la consommation rarement pris en compte
Dans le rendement énergétique comparatif de la section précédente, deux facteurs importants ont totalement été éclipsé (et le sont quasiment systématiquement). Le premier est l’auto-décharge de la batterie. Il faut savoir qu’une batterie perd environ 1% de sa charge chaque jour, soit plus de 3 charges complètes par an, qu’on utilise sa voiture ou pas.
Un autre aspect important, à véhicule équivalent (espace passager et de rangement), est qu’un véhicule électrique est beaucoup plus lourd que son équivalent thermique. Il y a le poids des batteries, mais il y a aussi le poids de tout le châssis qui doit pouvoir encaisser cette surcharge pondérale. Prénons la fiche technique du Peugeot 5008 1.6 THP 156 de 2012. C’est un véhicule 5 places avec un coffre de 823l mesurant 4,53m et pesant 1460 kg. Son équivalent électrique le E-5008 ELECTRIC 230 mesure 4,79m (+26cm) avec un coffre de 748l (-75l) et pèse 2275 kg (+ 815kg) !
Pour un véhicule thermique, chaque réduction de 10% du poids d’un véhicule entraîne une baisse de consommation de carburant de 5 à 8% (étude RNCan au Canada). La consommation de carburant d’une voiture particulière augmente de 7% quand le véhicule s’alourdit de 100 kg (Université de Gand, Belgique).
Si on intègre l’autodécharge, et surtout la surcharge pondérale, dans la comparaison entre un véhicule thermique et un véhicule électrique, le bilan énergétique développé dans la section précédente s’effondre totalement : la voiture électrique est bien plus énergivore que son équivalent thermique, contrairement à ce que laisse penser les rendements mis en avant de leurs moteurs respectifs !
Un véhicule électrique ne pollue pas du tout là où il roule
L’utilisation d’un véhicule électrique ne génère pas de gaz à effet de serre au moment du roulage (pas lors de la production ou lors de la recharge). Cependant, contrairement à une idée reçue, ils participent à la pollution de l’air en émettant des particules nocives. Selon une étude de l’Ademe, il n’existe pas d’écart significatif entre les émissions de particules des véhicules électriques les plus autonomes (et donc les plus lourds) et les véhicules thermiques récents dotés de filtres à particules. Les particules émises par l’abrasion des pneus, le contact des roues sur la chaussée (remise en suspension) ou encore les systèmes de freinage sont devenues largement prépondérantes par rapport à celles émises par les gaz d’échappement, note l’Ademe.
Le bilan CO2 d’un véhicule électrique est largement favorable
En raison de la fabrication des batteries et du poids des véhicules, avant même d’avoir roulé, une voiture électrique a une dette carbone de 5 à 15 tonnes équivalent CO2, selon les modèles. Cette empreinte est 2 à 3 fois supérieure à celle d’un équivalent thermique, indique l’Ademe. Cependant, à l’usage, le CO2 émis par une voiture électrique est lié à la fabrication d’électricité pour la recharger. La production d’électricité en France étant très largement décarbonée, sur l’ensemble de sa durée de vie (200000km), une voiture électrique roulant en France a un impact carbone 2 à 3 fois inférieur à celui d’un modèle similaire thermique, conclut l’Ademe.
Notons au passage que dans mon foyer de 4 personnes, nous possédons 2 véhicules. Il faudra 22 ans au premier pour atteindre les 200000km et 40 ans au second. Les seconds véhicules des ménages roulent en moyenne 6000 km par an, soit plus de 30 ans pour atteindre les 200000km. Les véhicules électriques pourront-ils vraiment atteindre ces durées de vie pour compenser largement la dette carbone de leur fabrication ? Sans changer de batterie ?
D’autre part, comme le montre une étude de Shrink that footprint, dans un pays avec un mix énergétique comme celui de l’Inde, le bilan carbone d’une voiture électrique est très défavorable par rapport à celui d’un véhicule thermique. C’est tout à fait logique : au début de ce billet, nous avons montré qu’un véhicule électrique est bien plus énergivore que son équivalent thermique. Donc, si la production de l’énergie électrique nécessaire à sa recharge est carbonnée, le bilan CO2 du véhicule électrique devient implacablement défavorable.
Le mix énergétique Français est largement décarboné
Le mix énergétique Français est largement décarboné : 40% de nucléaire, 28% de pétrole, 16% de gaz naturel, 14% d’énergies renouvelables et déchets et 2% de charbon. Faut-il se baser sur ce mix pour estimer l’intérêt d’un véhicule électrique roulant actuellement en France ? Oui, évidemment (1). Peut-on en conclure que si ce calcul est favorable, il faut remplacer l’ensemble du parc de véhicule thermique comme cela est actuellement planifié ? Absolument pas.
Pour électrifier tous les moyens de transport, nous aurions besoin d’environ 40 réacteurs nucléaires de 1 GW.Entre la prise de décision de la construction d’une centrale nucléaire et sa mise en service, il faut compter une vingtaine d’années. Le réseau hydraulique Français est saturé de barrages. À court et moyen termes, l’essentiel de la croissance de la puissance énergétique Française pour alimenter le parc rapidement croissant des voitures électriques viendra nécessairement d’une énergie en grande partie carbonée. Et nous savons que le bilan carbone d’une voiture électrique dans le contexte d’une électricité carbonée est négatif. Donc, même dans un pays où le mix énergitique est largement décarbonée comme la France, le passage à marche forcée au véhicule électrique va très probablement se solder par à un bilan carbone largement négatif.
(1) En réalité, ce n’est même pas le cas. Les pays avec un mix énergétique largement décarboné, comme la France ou le Canada, vendent leur excédent d’électricité à leurs voisins, tels que l’Allemagne ou les États-Unis. Par conséquent, chaque voiture électrique dans ces pays augmente la consommation électrique locale et réduit l’excédent disponible à la vente. Les pays voisins, pour compenser cette réduction, sont contraints de se tourner vers des sources d’énergie carbonées, qui sont actuellement le principal levier d’ajustement.
Plus d’énergie décarbonée pour moins d’énergie carbonée ?
Pour que l’introduction d’un véhicule électrique ait un sens au niveau du bilan CO2 de la planète, il faut que le carburant que son équivalent thermique aurait utilisé ne le soit pas. Autrement dit, il faut augmenter la production d’énergie électrique non carbonée, et réduire dans la même proportion, la quantité d’énergie fossile consommée. Or la production de pétrole est une activité assez tendue, notamment en raison des ressources limitées de la planète. La production d’une énergie électrique non carbonée pour alimenter un parc automobile électrique va entraîner une baisse de cette tension, et donc une baisse du coût de cette ressource, et donc des opportunités pour l’utiliser pour d’autres choses ou ailleurs. En d’autre terme, le recours massif à la voiture électrique, même dans l’hypothèse d’une énergie décarbonée, ne va pas entraîner une baisse équivalente de la production de pétrole. La production de pétrole va certes baisser un peu, mais pas du tout dans les mêmes proportions. En réalité, l’augmentation de la consommation d’énergie décarbonée va surtout faire augmenter la somme (énergies carbonées + énergie décarbonée). Comment rembourser la dette carbone des véhicules électriques dans un tel contexte ?
Rouler en électrique coûte 3 fois moins cher
À l’heure du carburant à 2€/l, bon nombre de conducteurs commencent à trouver la facture du plein insoutenable. Certains renoncent à des trajets, certains privilégient la marche à pied ou le vélo quand c’est possible, d’autres vont s’efforcer de covoiturer. La voiture électrique est trois fois moins chère en consommation. Cela revient à faire passer le prix du carburant à 0,6€/l ! Qui peut affirmer dans un tel contexte qu’il ne se permettra pas de rouler plus qu’avec un carburant à 2€/l ? C’est ce que l’on appelle un effet rebond : c’est-à-dire qu’un avantage apparent induit un changement de comportement qui annule, voir inverse, les effets positifs de cet avantage. Donc même avec un petit avantage carbone à la voiture électrique au km parcouru, cet avantage hypothétique sera balayé par les km parcourus supplémentaires induits par un coût au km aussi faible.
Quid de la fiabilité et de la durée de vie d’une batterie ?
Avec moins de pièces mobiles, les voitures électriques nécessitent généralement moins d’entretien que les véhicules traditionnels. Cependant, les véhicules électriques se révèlent nettement moins réparables pour plusieurs raisons : systèmes électroniques et logiciels avancés, conception beaucoup plus intégrée (« giga-casting »), disponibilité des pièces, batterie… L’association HOP (Halte à l’obsolescence programmée) alerte sur le phénomène de fast-fashion qui frappe principalement, mais pas seulement, l’automobile électrique.
Le changement d’une batterie représente approximativement 50% du prix du véhicule neuf. Les constructeurs garantissent généralement leur batterie pour une durée de 8 ans et une tenue de charge de 70% (c’est très variable selon les constructeurs). Autant dire qu’un problème de batterie non garanti entraînera quasi systématiquement la fin de vie du véhicule. Il faut donc espérer que les batteries seront capables de tenir les 200000km sur une grande majorité de véhicules (donc au minimum 30 à 40 ans ??). Sinon, comment rembourser la dette carbone de mise en circulation des véhicules électriques ?
Quid de l’autonomie sur autoroute ?
Prenons une voiture électrique qui affiche une autonomie de 450km. Cette autonomie est donnée pour une batterie avec une capacité de 100% (neuve), chargée à 100% (il ne faut jamais le faire), vidée à 0% (il ne faut jamais le faire) et dans les meilleures conditions de température et de vitesse. Tout d’abord, il faut garder environ 20% de batterie (pour la préserver et par sécurité), et on ne peut la recharger qu’à 80% (pour la préserver et pour charger rapidement). Donc on n’utilise réellement que 60% de la capacité de la batterie, ce qui réduit l’autonomie à 270km. À 130km/h sur autoroutes, la voiture électrique consomme vraiment beaucoup plus que ce que mesure le cycle d’homologation WLTP, réduisant sont autonomie de 40%. On tombe donc à une autonomie de 160km. Si la batterie a plus d’un dizaine d’années, il faut lui enlever 20% d’autonomie, on tombe alors à 130km. S’il fait froid, l’autonomie peut chuter de 10% à 50% selon les modèles et la température. Avec une autonomie nominale (marketing) de 450km, on peut donc très vite se retrouver avec moins de 100km d’autonomie sur autoroute (et je n’ai pas parlé de l’utilisation de la climatisation ou de tracter une remorque). Sur un trajet de 1000km, avec 150km d’autonomie, il faudra prévoir 3h de recharge (6 arrêts de 30min), avec 100km d’autonomie, il faudra tabler sur 4h30min de recharge (9 arrêts de 30min). Autant dire qu’en électrique, si les petites distances sont un plaisir, les grandes distances deviennent une vraie galère.
Conclusion
Que faut-il conclure de ce long billet ? Attention, ce billet n’est aucunement un pamphlet contre les voitures électriques ! Je pense même que les voitures électriques sont de bonnes voitures. L’objet de ce billet est de montrer que les voitures électriques ne sont pas du tout des voitures propres. Pire, il est cohérent de penser qu’à court terme comme à moyen terme, non seulement les voitures électriques ne sont pas propres, mais elles ne sont même pas plus propres que leurs homologues thermiques !
Mais, dans ce cas, pourquoi l’Union européenne a-t-elle entériné l’interdiction de la vente des véhicules à moteur thermique à partir de 2035 ? Nos politiques ont-ils cédé aux lobbys des constructeurs automobiles pour vendre des voitures plus chères ? Des producteurs d’électricité pour augmenter leurs bénéfices ? D’écologistes pavés de bonnes intentions ?
Voici des éléments qui, pour moi, permettent d’expliquer cette décision :
- L’Europe dépend fortement des importations de pétrole (à 90 %), notamment de régions politiquement instables ou avec lesquelles les relations sont complexes, comme la Russie et le Moyen-Orient.
- Environ 65 à 70 % du pétrole en Europe est destiné au secteur du transport.
- La guerre en Ukraine a débuté officiellement le 24 février 2022 avec l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie.
- Depuis, l’Europe a accéléré ses politiques de diversification énergétique pour s’affranchir des combustibles fossiles russes.
- Le 14 février 2023, le Parlement européen valide le texte interdisant la vente des véhicules neufs à essence et diesel à partir de 2035, et le Conseil de l’Union européenne l’adopte définitivement le 28 mars 2023.
Sous cet éclairage, on peut imaginer que la décision d’interdiction de la vente des véhicules à moteur thermique à partir de 2035 n’est pas dictée par des considérations écologiques, mais plutôt par des préoccupations économiques et politiques, tout à fait légitimes par ailleurs.
Les mesures figurant dans le présent règlement sont nécessaires dans le cadre d’une démarche cohérente et logique indispensable pour atteindre l’objectif général de l’Union consistant à réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre ainsi que la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles importés. (EUR-Lex, Document 32023R0851)
Informations et sources
Quel est le rendement réel des voitures électriques
Quelle est la perte électrique d’une recharge ?
Etudes : le poids d’une voiture détermine la consommation
Pollution de l’air : les voitures électriques émettent beaucoup de particules fines
Sont-elles vraiment écologiques ?
Interdiction des véhicules thermiques : une fausse bonne idée ?
Voiture électrique : pas la panacée partout !
Combien de centrales faut-il construire pour électrifier toutes les voitures de France ?
Quelle est la durée de vie d’une batterie de voiture électrique ?
Tout sur la durée de vie des batteries
Possibles effets négatifs des voitures électriques
La voiture électrique : révolution ou fausse bonne idée ?
Les véhicules électriques se révèlent moins réparables
ChatGPT